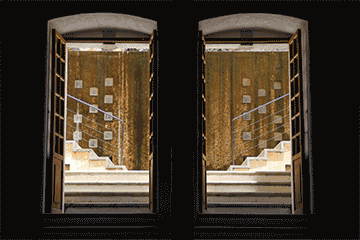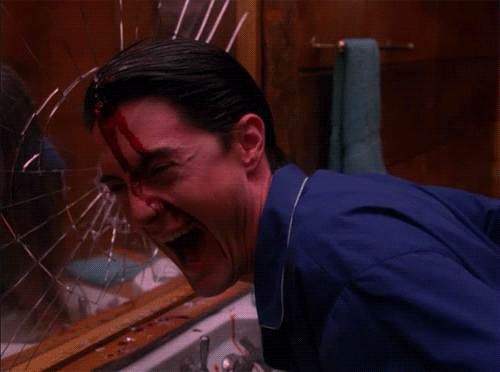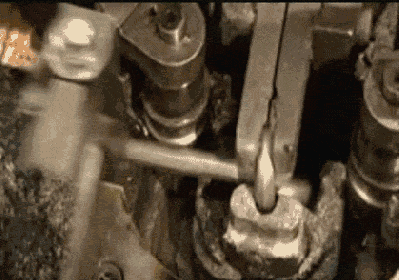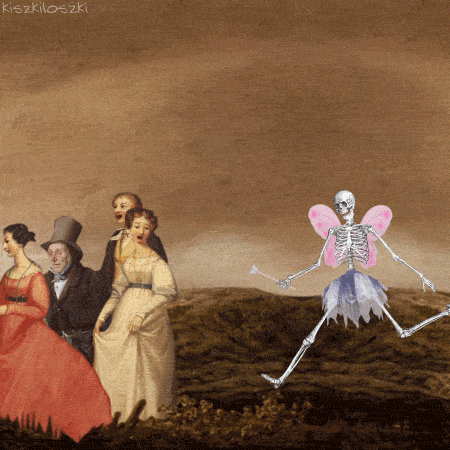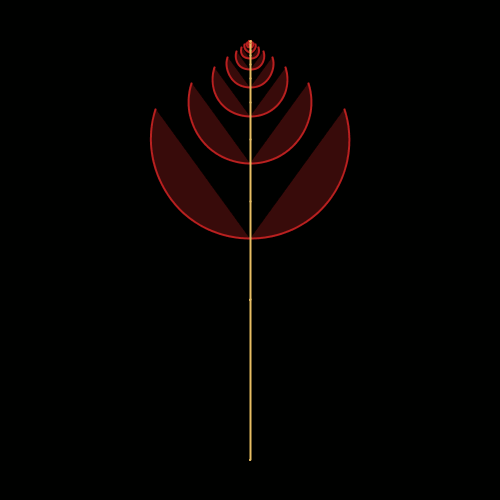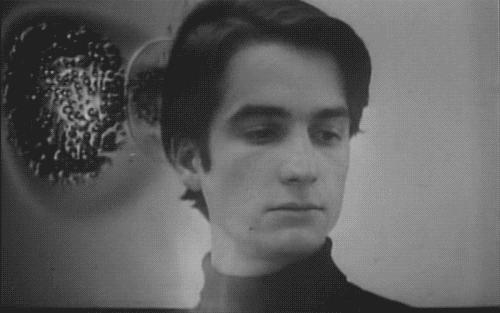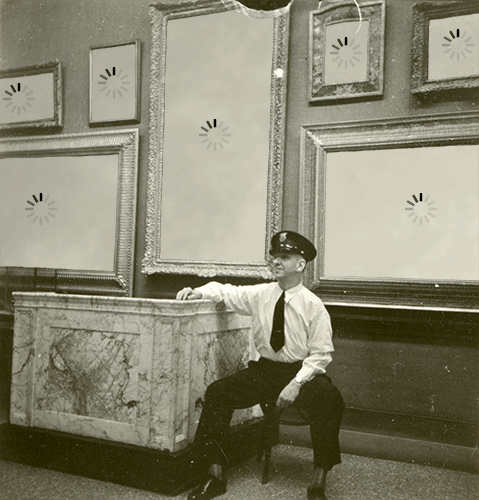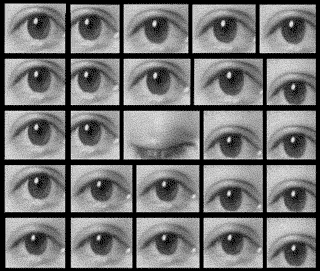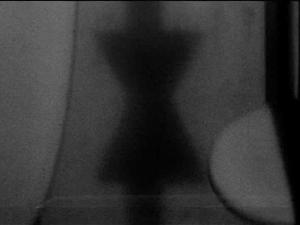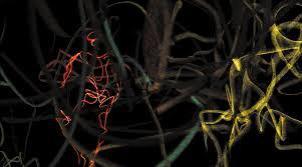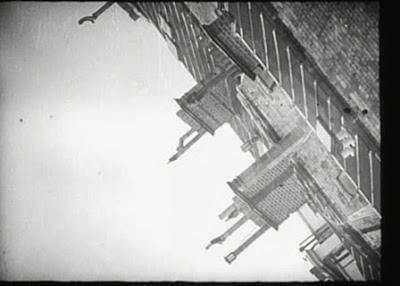ENGLISH SUMMARY: In this article, Aude Thuries explores the political dimensions of Gene Kelly’s musical films. As a “liberal” American, often incarnating a man of the people, Kelly promotes integration alongside his African American dance colleagues in The Pirate, while engaging with elements of everyday life in his choreography, thereby proposing a democratized dance and a vision of “dance for all”.
En 2016, Channing Tatum incarne pour les frères Coen le personnage de Burt Gurney, avatar de Gene Kelly dans Hail Cesar, relecture rocambolesque de l’âge d’or d’Hollywood. Au fil du récit, Burt Gurney se révèle être la figure de proue d’un groupe de communistes hollywoodiens à la solde de l’URSS. Les réalisateurs s’amusent ici à caricaturer les positions anti-maccarthistes de l’authentique Kelly. Le personnage est introduit via une séquence musicale qu’il est supposé tourner dans un des studios, « No Dames » :

(« No Dames », Hail Cesar, Joel et Ethan Coen, 2016) –> lien
Dès cette scène, ses sympathies pour les idéologies communistes sont révélées de manière détournée : en effet, juste après avoir coupé, le metteur en scène reproche à son acteur d’avoir lancé le torchon sur le second rôle jouant le barman, lui offrant ainsi un gros plan dont on aurait très bien pu se passer. Le Gene Kelly de caricature est présenté comme offrant à l’homme du peuple le beau rôle… et annonce par-là ses convictions politiques à contre-courant, que nous découvrirons dans le reste du film.
Le « gros plan du torchon » amène à s’interroger : est-il possible de percevoir, dans des numéros dansés apparemment innocents, dans des comédies musicales apparemment inoffensives, des enjeux politiques sous-jacents ? Cette question n’est pas neuve. Plusieurs spécialistes du genre l’ont posée, et c’est sans doute parce que la comédie musicale est a priori apolitique qu’il s’avère si passionnant de la regarder de plus près. Pour citer Alain Masson, « le musical ne contient pas de thèses politiques au sens trivial du terme […]. Les implications politiques résident ailleurs, dans l’éloge de la liberté et de la spontanéité, dans l’exigence de la cérémonie sociale, ou inversement dans le mépris des déterminations historiques et dans la réduction de la communauté à la fête, et de la cité à la communauté. […] Les valeurs idéologiques sont donc en même temps les valeurs esthétiques1. »
On pourrait dire aussi que les comédies musicales sont de facto politiques en ce qu’elles sont le reflet de l’industrie qui les a produites et qu’elles épousent de fait les valeurs de cette dernière. Difficile en effet de ne pas y voir une autocélébration de l’industrie du divertissement, des films à la gloire de l’Amérique consumériste… Néanmoins, dans ce paradigme économique et artistique, une parole d’auteur peut-elle se faire entendre, et en particulier une parole plus originale sur le plan politique et idéologique ? Dans ce cadre très contrôlé, existe-t-il une place pour des discours plus subversifs, ou plus radicaux, en marge des attentes familialistes, optimistes et capitalistes du genre ? C’est cette question que nous aimerions soulever en nous penchant sur l’œuvre de Gene Kelly, et en observant de quelle manière la dramaturgie, la chorégraphie et la mise en scène peuvent être en elles-mêmes, dans les comédies musicales, porteuses d’un sens parfois en décalage avec leur promesse initiale de divertissement bon enfant. Au-delà de l’intention première et ouvertement affichée, des mécanismes plus subtils sont à l’œuvre, construisant (ou déconstruisant) la portée politique de ces ouvrages diffusés à grande échelle.
Gene Kelly était un libéral au sens américain du terme, positionné à gauche, donc, sur le spectre politique des Etats-Unis. Cela se perçoit-il dans ses musicals ? Ne limitons pas cette question aux seuls films dont il est le (co)-réalisateur, mais étendons-la à l’ensemble de sa filmographie : d’abord, parce que Gene Kelly avait suffisamment de poids dans l’industrie pour infléchir le scénario et la direction des films ; ensuite, parce qu’il a très souvent eu le contrôle des scènes musicales dont nous allons parler ; enfin, parce que son corps et sa danse portent en soi un sens au service duquel se mettent bien souvent l’image et la narration, nous le verrons.
Gene Kelly, un « homme du peuple »
Ce que le corps de Gene Kelly charrie comme imaginaire ne se prête pas à tous les rôles et à tous les films. On le perçoit d’autant plus lorsqu’on le compare, l’oppose ou le rapproche de celui de Fred Astaire. Dans une émission enregistrée avec David Frost, en 1977, Gene Kelly a déclaré : « Fred was the aristocracy of dance ; I was the proletariat ». Il faut noter, comme l’a fait remarquer Robert Kaufman dans un article intitulé, de manière un peu provocante, « Singin’ in the Marxist Rain2 », que le terme de prolétariat est très marqué idéologiquement et peu courant en anglais, où lui est habituellement préféré celui de working class. Cette citation apparaît comme un point de départ intéressant pour éclairer sa filmographie : en quoi Gene Kelly est-il le prolétariat de la danse ?
On peut déjà constater, pour commencer, qu’il incarne souvent le prolétaire de la comédie musicale. Les rôles qui lui sont confiés sont ceux de gens d’extraction populaire : Singin’ in the Rain (Stanley Donen/Gene Kelly, 1952) et Match d’amour (Busby Berkeley, 1948) retracent des débuts à la petite semaine, la taille de son logement dans Un Américain à Paris (Vincente Minnelli, 1951) nous dit tout de ses revenus, le marin d’Un jour à New York (Stanley Donen/Gene Kelly, 1949) est avant tout un petit provincial. Et même lorsqu’il incarne un metteur en scène reconnu et prospère (Les Girls, George Cukor, 1957), il finit en vendeur de jus d’orange. Son physique, son allure, sa diction, appellent plus volontiers ce type de rôles populaires.
Mais le plus intéressant à observer, c’est sans doute ce que son corps fait à la danse – ce que Kelly incarne par la danse. Je reprends à nouveau, à cet égard, une analyse d’Alain Masson : « Au délié d’Astaire, Kelly oppose sa puissance. Son corps forme une totalité où, diachroniquement et synchroniquement, les gestes s’entraînent les uns les autres sans passer par la médiation de l’intelligence. Un parfait équilibre de position reste toujours présent dans son dynamisme. Le puissant balancement des bras et des épaules reflète et compense l’agitation des jambes ; le geste ne se détache ni du précédent : il s’y pose, ni du suivant : il y dure3. » Les points qui, à mon sens, abondent dans le sens de l’auto-analyse de Gene Kelly d’un « prolétariat de danse » figurent d’abord dans cette intrication. D’une certaine manière, Gene Kelly est enchaîné à son corps, il ne masque dans sa danse aucune prise d’élan, aucun ancrage, aucune compensation d’équilibre. Chaque mouvement est la conséquence du précédent et entraîne le suivant. Astaire au contraire semble faire par ses pas une démonstration de son bon vouloir, de la parfaite autonomie, de la discrète supériorité de son esprit sur son corps, de la liberté qu’il conserve toujours d’envoyer sa jambe ici ou là. Une liberté d’aristocrate.
Il faut aussi rappeler, bien sûr, la physicalité injectée par Kelly dans la tap dance et l’inédite implication musculaire que ses chorégraphies requièrent. Gene Kelly, lorsqu’il danse, exhibe des capacités athlétiques qui fleurent bon l’éducation sportive populaire. Il exalte le corps glorieux d’une certaine idée du travailleur manuel ou du travailleur en plein air, de complexion plus solide que la pâle et mince jeunesse dorée de Manhattan. Souvent sa danse va chercher des points d’appui (mains au sol, pieds aux murs) jamais vus auparavant dans les numéros chorégraphiés, crapahutant par-ci, escaladant par-là, contribuant à forger cet imaginaire du vigoureux Irlando-américain de la working class.
Le backstage musical, un genre réflexif ?
Mais cette image d’« homme du peuple », est-elle instrumentalisée par des discours, des messages ? Il faut, pour explorer cette question, rappeler préalablement quelques débats : du Gesamtkunstwerk wagnérien à la distanciation brechtienne, nombreuses sont les théories esthétiques qui réfléchissent la coprésence au sein d’une même œuvre de différents champs artistiques, que cela soit sur scène ou à l’écran. Chanter, jouer et danser tout à la fois est ainsi rarement un projet innocent : il est tantôt perçu comme une communion hypnotique, une grande messe collective – dont il faudrait prévenir les potentielles dérives totalitaires –, tantôt comme une juxtaposition qui amène le public à prendre conscience de l’artificialité du spectacle qu’on lui présente et à questionner de manière active et productive le spectacle proposé. Il faut ainsi noter qu’il a aussi été fait de la comédie musicale une lecture opposée à celle que nous présentions en introduction. Autrement dit, loin d’être uniquement envisagée comme une grand-messe capitaliste, un simple panégyrique de l’american way of life, la comédie musicale a également été perçue comme une inspiration pour son questionnement distancié, par son caractère ouvertement conventionnel et non réaliste et sa mécanique d’enchaînement de scènes musicales et non musicales. Adorno et Eisler, les premiers, font cette observation en 1947 : « Les musiques de scène intermittentes dans le drame ou les passages et numéros chantés des comédies sont les véritables ancêtres de la musique de cinéma. Ceux-ci n’ont jamais produit la positive illusion d’une unité des moyens d’expression et, partant, l’illusoire caractère d’un ensemble, au contraire, ils intervenaient, précisément, comme des éléments étrangers, stimulants du fait même qu’ils rompaient le contexte dramatique clos ou qu’ils tendaient à le faire passer de la sphère du vécu immédiat à celle des significations. […] La plupart du temps ce sont les films de revue qui approchent le plus de l’idéal du montage, et c’est alors que la musique y remplit sa fonction avec le plus de précision4. » Par films de revue, il faut entendre les comédies musicales du type des Gold Diggers ou Ziegfeld Follies, qui s’avèrent selon les auteurs proches de l’idéal du montage eisensteinien, censé opérer des chocs à même de susciter la réflexion et de maintenir le public conscient de l’artificialité du spectacle.
Les « films de revue » dont parlent les deux théoriciens peuvent rentrer dans la catégorie plus large du backstage musical, « film de coulisses » dont l’intrigue suit généralement les affres de la préparation d’un show, des difficultés de production jusqu’aux liens amoureux qui se tissent entre protagonistes. Ce genre peut apparaître très critique envers l’industrie dont il est lui-même issu, et Gene Kelly a tout particulièrement contribué à porter à l’écran des films de coulisses assez grinçants, parmi lesquels Singin’ in the Rain, fait figure de sommet. Plus généralement, les films de Kelly questionnent largement le monde du show-business et ses mirages : sans parler de Beau fixe sur New York (Stanley Donen/Gene Kelly, 1955) et de sa satire amère du monde de la télévision, on peut prendre en exemple Les Girls, dont l’histoire est racontée trois fois, du point de vue des trois protagonistes féminins. Ainsi, la pancarte « où est la vérité ? », posée à l’entrée du tribunal au début du film, donne le ton d’emblée : le film nous invite à ne pas nous laisser hypnotiser, à tout interroger. Citons également Match d’amour, dont le final s’emploie admirablement à exhiber l’artificialité du spectacle qu’il vient de proposer :

(Match d’amour, Busby Berkeley, 1948) –> lien
Tous assis !
Chapeau bas !
La comédie n’est pas jouée.
Les couples doivent se former
Avant le fondu final.
Garrett est pour Sinatra,
Williams est pour Kelly,
Ainsi le veut le scénariste.
Et ce duo doit se changer
En quatuor
Pour finir en beauté 5…
Match d’Amour, sous ses airs de drôle d’hybridation entre comédie musicale et film de sport, est sans doute l’une des comédies musicales hollywoodiennes les plus ouvertement politiques. En 1949, tandis que le maccarthysme est en train d’épurer d’Hollywood de ses activistes « anti-américains6 », elle propose une vision toute différente de l’identité nationale et du patriotisme : c’est parce qu’on aime le base-ball – et un tas d’autres choses similaires – que l’on se sent américain, quelle que soit son origine, quelle que soit son orientation idéologique. La dimension politique passe ici par la célébration d’un vivre-ensemble en musique, « Strictly U.S.A ». Chaque origine apporte ses tonalités musicales propres qui, réunies, font toute la richesse du musical – et métaphoriquement, de l’Amérique. Le final évoqué ci-dessus reprend la partition de « Strictly U.S.A », pour nous chanter cette fois les astuces des scénaristes… Gene Kelly ainsi distancié de son personnage à l’écran s’y muerait-t-il en acteur brechtien, dans un genre qui, on l’a vu, favoriserait déjà les procédés d’interruption et de montage eisensteiniens ?
Il faut en réalité dissiper cette vision d’un Gene Kelly chantre d’un matérialisme historique joyeusement exposé dans ses comédies musicales. En premier lieu, parce que l’acteur-danseur-réalisateur n’était pas un adepte des procédés d’interruption : on sait qu’il n’aimait pas les ruptures nettes avec la continuité dialoguée, la brusque intervention du chant et de la danse que louent à l’inverse Adorno et Eisler. A l’opposé d’un choc dialectique, tout son art consiste à amener organiquement le corps à se mouvoir dans la scène, à le faire doucement « entrer en danse ». C’est tout le sens du « Doudidou », passé à la postérité, de Singin’ in the Rain7 : une progressive incursion dans la parenthèse onirique du numéro musical.
En second lieu, parce que la portée réflexive et critique des œuvres citées doit être relativisée. Ainsi, à en croire Jane Feuer, ce n’est qu’en apparence que le backstage musical explore ses apories, ses paradoxes et ses hypocrisies. L’universitaire développe l’idée d’une « réflexivité conservatrice » caractéristique du genre : le film de coulisses lève le rideau sur les arcanes du spectacle, mais ne déconstruit pas. Au final, les héros ont toujours du talent, dansent toujours avec spontanéité et l’entertainment est toujours célébré8. Le dévoilement des coulisses n’implique pas davantage de « vérité » ou de discours critique – à l’heure de la télé-réalité, l’adage n’en est que plus vrai. Le backstage musical relève plutôt, selon Jane Feuer, du rite nécessaire à la cohésion du peuple, par l’affirmation renouvelée de ses valeurs et de son mode de vie. Il correspond en outre à une volonté de transformer le « mass art » qu’est la comédie musicale en « folk art », art du peuple, impliquant – illusoirement – le spectateur dans le processus de fabrication du show. Une envie que l’on peut lire entre les lignes de Gene Kelly lui-même, lorsque, dans la préface d’une anthologie, il affirme à propos du film musical : « It’s one of the few peculiarly American art forms and, at its bests, it certainly is art9 ».
Danser ensemble, en douce…
Parfois, cependant, ces films à la « réflexivité conservatrice » (les films de coulisses ne sont d’ailleurs pas les seuls à relever de cette catégorie) ont une réelle portée transgressive ou progressiste, et se découvrent la capacité de changer les mentalités sur des questions idéologiques, politiques ou sociétales – une capacité d’autant plus grande qu’elle est insensible.
Cela mérite explications et exemples : commençons par rappeler qu’un des ressorts les plus importants de cette « réflexivité conservatrice » est ce que Jane Feuer appelle le « mythe de la spontanéité », cette convention qui nous montre les héros touchés par la grâce, naturellement talentueux, capables d’improviser parfaitement et conjointement les numéros les plus complexes. Cela participe de la fluidité avec laquelle est conduit le récit et répond à une exigence de spectaculaire qui sait passer avant le réalisme. Les scènes et les numéros de la comédie musicale « spontanée » se succèdent comme s’ils glissaient les uns à la suite des autres, sans que rien ne freine leur merveilleux enchâssement – n’en déplaise à Adorno et Eisler. Mais c’est justement parce que l’émerveillement et l’immersion l’emportent sur la prise de recul et le regard critique que l’esprit du spectateur peut devenir soudain réceptif aux configurations les plus inédites et les plus militantes : « Be a Clown » (Le Pirate, Vincente Minnelli, 1948) est ainsi un numéro qui loue, très traditionnellement, les vertus de la vocation d’entertainer – alors qu’il montre Kelly dansant, d’égal à égal, avec les Nicholas Brothers, danseurs noirs. Un trio inédit à l’initiative de Kelly le libéral, volontiers choquant pour une partie de l’Amérique d’alors, s’il n’était enchâssé dans le film avec une décontraction, une virtuosité et une bonne humeur à même de détourner de tout questionnement racial le plus réactionnaire des spectateurs. Parce que cette danse entre Blanc et Noirs est un non-événement dans le film, elle a une portée politique.
Ce trio a ouvert la voie à d’autres collaborations : que l’on pense ainsi à Gregory Hines et Mikhaïl Barishnikov se lançant, dans Soleil de nuit (Taylor Hackford, 1985), dans une improvisation de concert qui répond parfaitement à cette spontanéité toute cinématographique décrite par Jane Feuer. Là encore, c’est la subversion douce des motifs traditionnels qui irrigue le film d’un sens nouveau : le Blanc et le Noir, le Russe et l’Américain, le transfuge et le déserteur, l’artiste élitiste et l’entertainer populaire parviennent magiquement, et magnifiquement, à danser ensemble. Le « mythe de la spontanéité » sert parfois à conférer légitimité et fierté aux unions autrefois difficiles à concevoir, en leur offrant les honneurs de la grande forme hollywoodienne.

(« Be a Clown », The Pirate, Vincente Minnelli, 1948) –> lien
Pour un « folk art »
Ce n’est pas à ce seul titre que « Be a Clown » mérite d’être mentionné – il est temps d’aborder maintenant un versant essentiel, sinon majeur, de la carrière de Gene Kelly, à savoir la chorégraphie. A propos de cette séquence du Pirate, tournée en un seul jour, Kelly a déclaré : « je cherchais l’occasion de danser autrement, dans un style populaire avec des formes classiques, de l’acrobatie et de la gymnastique10. » C’est là un de ses traits marquants en tant que chorégraphe : la recherche de l’hybridation, l’inclusion de multiples influences, jusqu’à transformer la tap dance initiale en une forme dont les termes de « jazz » ou de « classical tap » ne révèlent que la complexité à la circonscrire. Mais surtout, cette hybridation puise tout à la fois dans les formes artistiques les plus nobles (ballet) et les plus populaires (acrobatie), pour aboutir à ce qui se rêverait comme un art pour tous, un art nouveau et proprement américain, ou plus justement un art du peuple américain. C’est à la fois le désir de Kelly chorégraphe et de Kelly réalisateur. On le retrouve ainsi lorsqu’il entreprend, pour le tournage d’Un jour à New York, d’investir les rues de la métropole : « nous avons vraiment essayé de faire du neuf dans le film musical. De vrais personnages sortent d’un vrai bateau dans le port de Brooklyn et chantent et dansent dans la ville de New York11. »
C’est bien dans la rue – même si elle est reconstruite en studio – que s’épanouit le plus la danse de Gene Kelly. L’acteur y met souvent un beau désordre, et ne manque pas d’y troubler la vie paisible des résidents. Faut-il y voir un acte militant ? A l’évidence non : dans chaque séquence, c’est sur le mode du jeu enfantin, qu’il soit rêveur ou turbulent, que le grabuge s’engage. Et quand bien même les choses sont momentanément dérangées, il s’agit d’un désordre accepté, parce qu’« il faut que jeunesse se passe ». Outre Singin’ in the Rain12, on peut prendre comme exemple « Make Way for Tomorrow » dans La reine de Broadway (Charles Vidor, 1944). De l’espace public, on cesse de prendre au sérieux les plus sommaires restrictions, comme la délimitation des espaces pour les piétons – le trottoir notamment, qu’on déborde allègrement. On joue avec les poubelles, on jette les pots de fleur des bons bourgeois, et ainsi de suite. Le policier a beau veiller, le trio n’en fait qu’à sa tête, et l’agent est pris au dépourvu. Tout en dansant, Kelly et ses compères chantent « Make Way for Tomorrow », et c’est là tout l’enjeu de la séquence : pour faire place à demain, il faut chambouler l’ordre existant. Sa danse détourne et transgresse ainsi systématiquement les voies réservées, les fonctions initialement dévolues aux objets. On oublie la finalité initiale d’un déplacement, l’objectif premier d’un geste, et ainsi délestés de leur visée productive, ils apparaissent comme un ballet en germe, et finissent par se transformer effectivement en danse. La poubelle fait des sons, l’escalier sert de scène, et qu’importe si la société leur a assigné des buts bien plus sérieux. Mais c’est finalement là, peut-être, un enjeu politique des plus sérieux : faire danser dans la ville, donner la possibilité au spectateur de percevoir le monde autrement qu’au travers des contours tracés par l’ordre établi.
L’enjeu est d’autant plus sérieux que le grabuge dansé sert souvent d’exutoire à une violence que la comédie musicale s’est également employée à dévoiler. Sans parler de West Side Story (Robert Wise, 1961), on peut évoquer Fred Astaire, ivre, éclatant des verres dans une danse de colère pour « One for my Baby » (The Sky’s the Limit, Edward Griffith, 1943). Jane Feuer n’hésite pas de son côté à citer deux autres films où figure Gene Kelly, Summer Stock (Charles Walters, 1950) et Beau Fixe sur New York : « Now in Dailey’s frantic violence [dans Beau fixe sur New York], destructive energy comes to the surface of the film in a quite disturbing way. We begin to see the dangerous undercurrent to the musical’s wholehearted endorsement of spontaneous energy (of course, the real equation between popular music and anti-social violence would emerge in the rock culture of the 1960s)13. »
Le détournement des objets de leur fonction première est par ailleurs l’une des clés du succès des numéros de Kelly, qui développe une tradition déjà bien installée par Astaire. Quand la violence décrite par Feuer advient, et qu’elle s’exerce sur l’environnement du danseur, c’est une manière également pour le musical de déconstruire (dans une démarche réflexive non conservatrice, donc) ce motif bien installé du numéro qui transforme des objets du quotidien en accessoires de danse. Une déconstruction d’autant plus virulente que, dans le sillage du « mythe de la spontanéité », le numéro de « bricolage » (terme que Feuer reprend à Levi-Strauss, dans son opposition à l’ingénierie) est un des socles de ce « folk art » vers lequel tendent les films de coulisses, et particulièrement l’œuvre de Gene Kelly. Les chorégraphies avec les objets, et la disposition opportune de ces derniers sur le plateau et le parcours du danseur, relèvent de l’ingénierie, de moyens techniques déployés et organisés selon une visée prédéfinie, mais cette visée est justement de nous faire croire au bricolage, c’est-à-dire à l’improvisation avec des éléments trouvés au hasard. Et le bricolage, parce qu’il est précisément le savoir-faire technique du peuple, est ce qui permet à la danse et au cinéma d’opérer la transsubstantiation souhaitée du « mass art » en « folk art », en tout cas dans les développements que lui a offerts Kelly : « Astaire appeared to use the prop dance out of a kind of despair – no partner of flesh could match his grace. Kelly made of it a peculiarly American institution, giving bricolage the stamp of good old American inventiveness14. »
Avec ces numéros bricolés, on rejoint le rêve du chorégraphe de danser dans des vraies rues et d’y introduire des figures populaires : le plus grand engagement politique de Kelly via l’art est certainement son désir d’une extrême démocratisation de la danse. Il appelait de ses vœux sa diffusion dans toutes les couches de la société et espérait généraliser sa pratique et son appréciation – comme éducation bénéfique des corps, comme sublimation de l’énergie destructrice, comme générateur d’une identité nationale positive. La danse avec « objets trouvés », outre l’émerveillement que suscite immanquablement la découverte d’un usage insoupçonné – un émerveillement sur lequel jouera également, plus tard, Jackie Chan dans le domaine des films d’arts martiaux – est aussi un art pauvre, virtuellement réalisable n’importe où, loin des grandes scènes de Broadway. De là, il aspire à être démocratique, en ce sens qu’il fait figure d’invitation pour chacun à prendre le pouvoir sur son corps et son environnement, pour les transformer, peut-être, en œuvre d’art. Et peu importe finalement que le bricolage d’Hollywood soit en réalité le produit d’ingénieurs, le fruit très coûteux des studios, tant qu’il fait, sur le chemin de retour du cinéma, danser le spectateur dans la rue – la vraie rue, cette fois.
Cette invitation au bricolage créatif et à l’occupation dansée de la rue, malgré le déclin de la comédie musicale et la fin du succès commercial de Kelly, a étonnamment trouvé son auditoire dans les générations suivantes. S’inspirant entre autres des films d’arts martiaux et des comédies musicales rediffusées à la télévision, une partie des jeunes issus des quartiers défavorisés du New York des années 70 a su se créer une culture visuelle, musicale et chorégraphique originale et spécifique – la société américaine voyant ainsi affleurer dans ses marges la plus authentique « American inventeness ». Le breakdance émergent est alors clairement une prise de pouvoir sur un environnement urbain et social qu’il s’agit de réinventer, de détourner et d’exploiter positivement, pour faire apparaître de nouvelles formes artistiques, pour acquérir une valeur dont on s’est fixé in situ l’échelle – en attendant que le reste du monde s’y intéresse, notamment l’industrie cinématographique qui y puisera matière à « films de danse ». Peut-être qu’une boucle est ici bouclée : Gene Kelly inspirant quelques figures du hip hop, le hip hop infusant à son tour les « films de danse », dont la franchise Step Up qui a vu débuter l’acteur-danseur Channing Tatum, celui-là même qui dans « No Dames » rend un hommage impertinent à Gene Kelly. Davantage sans doute qu’à la traditionnelle question de l’intention, la portée politique d’une œuvre se juge à ses réceptions et à ses transformations à long terme, à ses transferts et à ses filiations – surtout les plus inattendues.
1 Alain Masson, Comédie musicale, Paris, Stock, 1981, p. 19-20.
2 in Anke Finger and Danielle Follett (ed.), The Aesthetics of the Total Artwork: on borders and fragments, Johns Hopkins University Press, 2011.
3 Alain Masson, op. cit., p.282.
4 Theodor W. Adorno, Hanns Eisler, Musique de cinéma, trad. J.-P. Hammer, Paris, L’Arche, 1997, p. 82-83.
5 Cité dans Hugh Fordin, La comédie musicale américaine, trad. A. Masson, Paris, Ramsay, 1987, p. 199.
6 Gene Kelly, dont la femme sera blacklistée, s’engagera dans le comité de soutien des « Dix d’Hollywood ».
7 Voir Hugh Fordin, op. cit.
8 Voir Jane Feuer, Mythologies du film musical, sous la direction de Marguerite Chabrol et Laurent Guido, Dijon, Les presses du réel, 2016.
9 Gene Kelly, préface à John Springer, All Talking ! All Singing ! All Dancing ! A Picturial History of the Movie Musical, Citadel, 1969, p. 8.
10 Cité dans Hugh Fordin, op. cit., p. 199.
11 Cité dans Hugh Fordin, op. cit., p. 257.
12 Voir un précédent article : http://www.revue-urbanites.fr/3-dancing-in-the-street/
13 Jane Feuer, The Hollywood Musical, second edition, Indiana University Press, 1993, p. 108.
14 Ibid., p. 6.
Aude Thuries
Aude Thuries a publié “L’apparition de la danse” aux éditions L’Harmattan en 2016. Ses recherches portent sur le passage du geste quotidien au mouvement dansé, notamment sur les écrans. Elle a également réalisé un court-métrage de comédie musicale, “Du blanc à l’âme”, diffusé sur France Télévisions fin 2017.